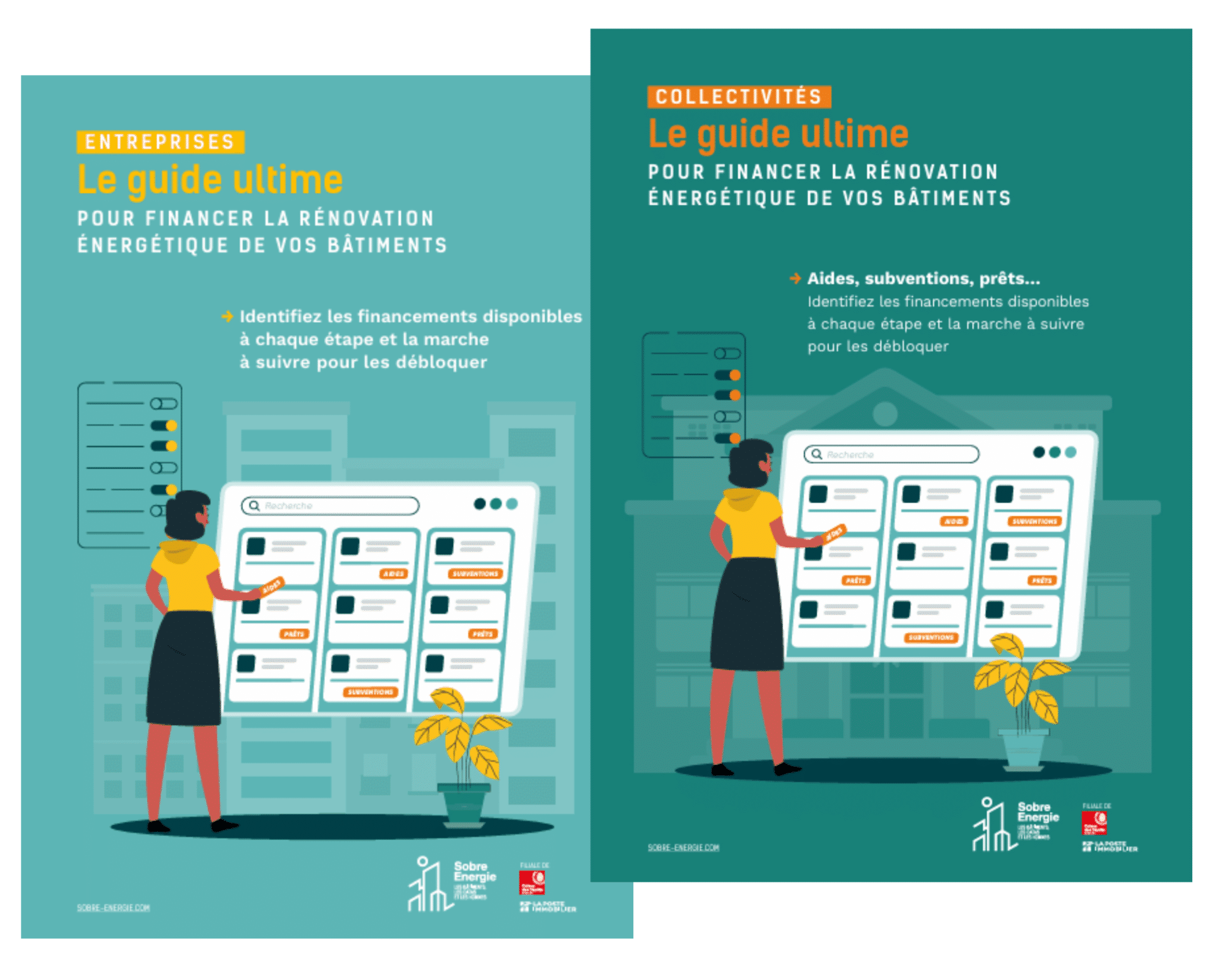Face à la crise énergétique, aux obligations réglementaires croissantes (Décret Tertiaire, BACS, loi APER…) et aux impératifs climatiques, la sobriété énergétique s’impose comme une réponse incontournable. Elle vise à repenser les usages de l’énergie pour réduire durablement les consommations, sans perte de confort ni recours systématique à des investissements lourds.
Pour les gestionnaires de parcs tertiaires, il s’agit d’une véritable stratégie de pilotage et de transformation. Voici les principaux leviers à activer, mis en avant dans le récent livre blanc de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID).
Des leviers techniques pour une sobriété efficace
Le premier niveau d’action repose sur une optimisation fine des systèmes techniques, qui peut être mise en œuvre rapidement à la suite d’un audit énergétique et à moindre coût :
- Réglage des consignes de chauffage et de climatisation : 19°C en hiver, 26°C pour la climatisation ; abaisser la température de consigne de chauffage de 1°C peut générer jusqu’à 7% d’économie.
- Horodatage et pilotage des plages de fonctionnement des équipements (CVC, éclairage, ventilation) selon l’occupation réelle des locaux.
- Gestion différenciée des espaces : chauffer ou éclairer uniquement les zones occupées, notamment en cas de taux de présence réduit.
- Réduction des consommations passives : extinction des veilles, réduction de l’éclairage artificiel quand l’ensoleillement naturel le permet, etc.
- Utilisation d’outils numériques pour le suivi en temps réel des consommations : systèmes GTB ou plateformes de monitoring comme Sobre Energie, recommandée par l’OID comme solution de management énergétique de la demande.
Ces actions s’inscrivent dans une logique de sobriété d’usage, distincte de l’efficacité énergétique : elles agissent directement sur les comportements et les consignes de fonctionnement.
Mobiliser les occupants : un levier comportemental majeur
La sobriété énergétique ne peut réussir sans l’adhésion des utilisateurs. Impliquer les occupants est donc essentiel pour installer des pratiques durables :
- Sensibilisation et formation : diffuser une culture de la sobriété (affichages, campagnes internes, ateliers d’échange participatif de type fresque).
- Partage d’objectifs collectifs : fixer des cibles de réduction et les rendre visibles (via un tableau de bord partagé, par exemple).
- Implication via des « green champions » ou référents énergie dans chaque service.
- Rétroaction sur les consommations : donner aux usagers une visibilité sur leur impact et sur les économies réalisées, en s’appuyant sur des solutions comme Sobre Energie, qui facilitent la communication et la visualisation des données.
Selon l’OID, ces actions comportementales peuvent générer entre 5 % et 15 % d’économies d’énergie sans aucun investissement technique.
Mesurer, suivre et pérenniser la démarche
Pour qu’une politique de sobriété s’ancre durablement, elle doit être mesurée, pilotée et réévaluée en continu. Cela implique :
- La mise en place d’indicateurs de performance énergétique : kWh/m², évolutions hebdomadaires ou mensuelles, analyses par usage (chauffage, éclairage…).
- La structuration de plans d’action par site ou par typologie de bâtiment, avec des revues régulières des résultats.
- L’intégration de la sobriété dans la gouvernance de l’entreprise (via des chartes, des engagements RSE, des budgets spécifiques).
- L’adoption d’un dispositif de management énergétique, comme la plateforme Sobre Energie, qui permet de centraliser les données, suivre les objectifs, et accompagner les responsables énergie dans l’analyse et l’animation de la sobriété.
Conclusion
La sobriété énergétique dans le secteur tertiaire ne doit plus être perçue comme un effort conjoncturel mais bien comme une nouvelle norme de gestion des bâtiments. En combinant leviers techniques, engagement des usagers et pilotage outillé, les organisations peuvent atteindre des réductions significatives de leurs consommations, tout en améliorant leur résilience et leur empreinte carbone.
Le défi est désormais d’institutionnaliser ces pratiques, pour qu’elles deviennent un réflexe partagé à tous les niveaux de l’organisation.