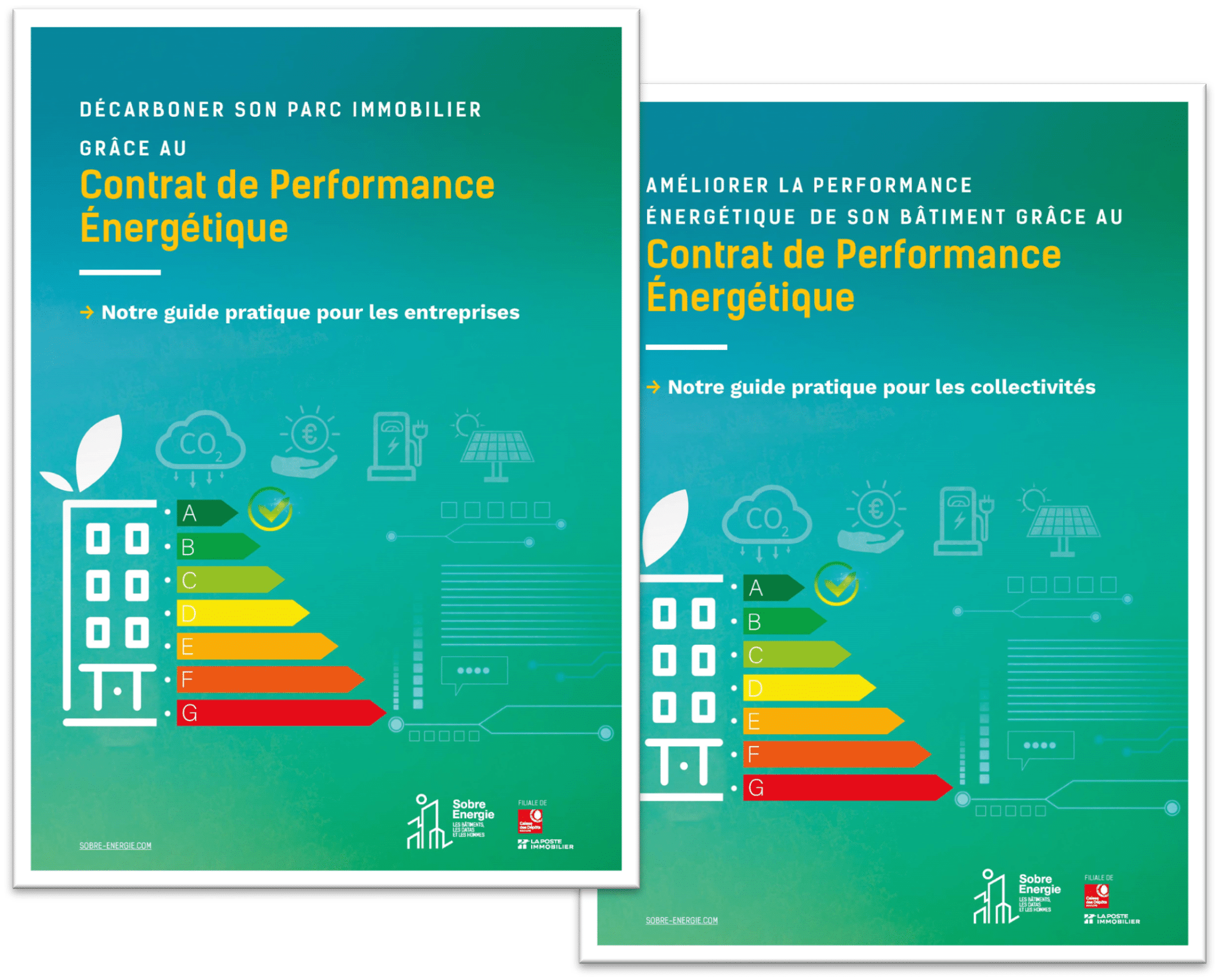Le jeudi 15 mai 2025, AMORCE a rassemblé experts énergie, décideurs et praticiens autour de la thématique « De la stratégie à l’action ». Cette journée de colloque, articulée entre exposés techniques et retours d’expérience, a permis de faire un point précis sur les obligations européennes, de partager des bonnes pratiques et d’offrir des pistes concrètes pour accélérer la transition énergétique des collectivités. Voici les enseignements :
Rappel réglementaire
La Directive européenne sur l’efficacité énergétique (DEE), récemment révisée dans le cadre du paquet législatif "Fit for 55", fixe désormais des objectifs renforcés pour les Etats membres de l’Union Européenne : une réduction moyenne annuelle de 1,9 % de la consommation d’énergie finale entre 2024 et 2030, ainsi qu’une obligation de rénovation énergétique portant sur 3 % par an de la surface totale des bâtiments publics.
En France, ces ambitions sont déclinées par le décret tertiaire (dit « Dispositif Eco Énergie Tertiaire »), qui contraint les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m² à suivre une trajectoire de performance chiffrée : – 40 % d’ici 2030, – 50 % d’ici 2040 et – 60 % d’ici 2050 (par rapport à 2010).
Cette double injonction européenne et nationale impose aux collectivités non seulement un rythme soutenu d’investissements et de travaux, mais aussi la mise en place de systèmes de pilotage et de suivi de la consommation afin de maîtriser budgets et empreinte carbone dans la durée.
Comparaison européenne et trajectoire 2030
Dans le cadre de la DEE, l’analyse croisée des bilans nationaux pour 2022–2023 révèle que la trajectoire vers 2030 est théoriquement atteignable : la baisse moyenne continentale avoisine les 2 %. Toutefois, la France présente une stabilisation préoccupante (+ 0,3 % corrigé climat entre 2023 et 2024) après une phase de – 4 % l’année précédente. Pour rester sur le droit chemin, il faudra compenser cette inflexion par un renforcement des investissements, sans se reposer sur l’effet de rattrapage issu des mesures d’urgence post crise. La convergence des pratiques avec nos voisins – notamment par un meilleur pilotage des bâtiments publics et résidentiels – sera déterminante.
Pourquoi économiser l'énergie ?
Au-delà des enjeux climatiques et de la souveraineté énergétique, les économies d’énergie génèrent plusieurs bénéfices :
- Soulagement budgétaire pour entreprises, collectivités et ménages.
- Amélioration de la balance commerciale en réduisant les importations d’énergies fossiles.
- Réduction de la pollution atmosphérique et préservation de la biodiversité.
- Justice sociale : la maîtrise des consommations énergétiques constitue un levier de lutte contre la précarité.
Ces arguments offrent un socle de motivation partagé pour accélérer les projets de rénovation.
La sobriété : d'une réponse de crise à un levier de long terme
Au-delà de ces obligations, c’est la sobriété énergétique qui a fait l’objet d’un véritable plaidoyer. Les chiffres sont parlants : après la crise ukrainienne, les collectivités françaises ont réduit de 12 % leur consommation sur l’hiver 2022–2023, preuve que ces pratiques peuvent devenir un réflexe durable, et non un simple plan d’urgence. Sobriété ne signifie pas austérité : il s’agit plutôt de mieux dimensionner, de mieux piloter et, surtout, de ne consommer « que ce dont on a besoin ». Chacun, du responsable d’un bâtiment public à l’habitant, peut contribuer à cette nouvelle culture d’usage raisonné.
Transformer cet état d’esprit « de crise » en pratique quotidienne exige un travail de formation, de sensibilisation et d’animation plus intense, notamment auprès des gestionnaires de bâtiments, des élus et des usagers. L’intégration systématique d’Energy Managers dans les structures souligne l’importance de l’expertise interne pour traduire les effets de leviers en économies réelles.
Des outils contractuels et financier en phase de maturation
La sobriété énergétique, socle de toute démarche de performance, trouve un relais réglementaire majeur dans le décret tertiaire, qui contraint les bâtiments à réduire leurs consommations sur un rythme progressif et chiffré. La trajectoire actuelle du décret tertiaire est encourageante mais appelle à la vigilance car les premiers résultats reposent majoritairement sur des actions simples et rapidement mobilisables.
Pour atteindre les objectifs à long terme, plus ambitieux, il sera nécessaire d’engager des démarches plus structurantes. Dans ce cadre, le Contrat de Performance Énergétique (CPE) s’impose comme un levier stratégique, en permettant de sécuriser les économies d’énergie sur la durée tout en structurant l’investissement.
Le CPE constitue l’outil opérationnel idéal pour traduire cette obligation en réalité concrète. Voici ses atouts :
- Engagement de performance et de qualité sur la durée du contrat.
- Montage simplifié : un seul interlocuteur pour piloter diagnostic, travaux et suivi.
- Rentabilité rapide grâce à une bonification financière.
L’Energy Manager joue un rôle clé dans la garantie de la réussite du projet.
Le CPE permet de structurer un plan d’actions de sobriété (optimisation des équipements, ajustement des consignes, formation des usagers) tout en sécurisant financièrement la collectivité.
En ce sens, le décret tertiaire pousse à identifier et déployer les gisements de sobriété et le CPE offre le cadre contractuel et technique pour en verrouiller les résultats et pérenniser les économies réalisées.
Le succès du Contrat de Performance Energétique (CPE) et l’émergence du MGPEPD montrent que les montages innovants se diffusent, apportant davantage de flexibilité et de sécurité aux porteurs de projet.